|
Histoire du Maroc
|
|
|
Phéniciens Romains Arabes Berbères Chérifiens Européens Français Indépendance Mohammed V Marche Verte Hassan II
|
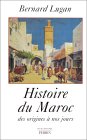 Quelque part près d'Asilah, une route difficile conduit à l'aride décor, où sont plantés plus
de cent cinquante menhirs, autour d'un tumulus. Bien peu de touristes s'y aventurent.
C'est pourtant là que vécurent les premiers habitants connus du Maroc, il y a quelque
cinq mille ans. À cette époque, l'Afrique du Nord est chaude et humide, le Sahara une
savane peuplée de grands animaux, les vertes vallées du Sud (le Drâa, le
Dadès) sont de
grands fleuves. Bien des siècles plus tard (XIIème siècle avant notre ère), les Phéniciens,
grands navigateurs, créent un port à Lixus, près de Larache et un autre sur l'île de Mogador,
face à notre actuel Essaouira. Puis Carthage s'y implante, comme dans pratiquement tout le bassin
méditerranéen. Les ports que sont aujourd'hui Melilla, Tanger, Asilah datent de cette époque
(VIème siècle avant notre ère), et durant près de cinq siècles, Carthage règne sur l'essentiel
du territoire marocain que nous connaissons. Le royaume de Maurétanie (ne pas confondre avec
la Mauritanie. au nord du Sénégal) gardera son nom après la chute de l'Empire carthaginois
(146 avant J.-C.) et pour les premiers Berbères, ces territoires maritimes s'ajouteront à l'ouest
de l'Algérie. Le royaume est riche. Il exporte de l'huile d'olive, des poissons séchés et marinés,
et envoie à Rome, pour le cirque, des animaux sauvages - lions et éléphants - qui pullulent encore
en Maurétanie. C'est une erreur. Tant de richesses attirent Caligula ; il fait assassiner Ptolémée,
le fils du souverain berbère Juba Il et, après quatre ans d'une guerre sans pitié, l'empereur Claude
déclare la Maurétanie, province romaine (en 42), ce qui en fait une suite naturelle des provinces Bétiques
(andalouses),où Claude est déjà implanté... Il s'en tient prudemment aux villes dont
il a besoin : Ceuta, Tingis (Tanger), Sala, Volubilis (la richesse du site montre le profit tiré de
leurs nouveaux territoires par les Romains) et laisse les seigneurs berbères gouverner le reste
du territoire et lui apporter leurs tributs. Cela dure six siècles. Comme toujours dans l'histoire,
c'est la richesse du pays qui attire les ennemis. Les Arabes venus de Tunisie mettront trente ans
à soumettre les Berbères, mais en 710, Ibn Noussair prend le pouvoir ; il nomme Tarik gouverneur
de Tanger et, histoire de ne pas être encombré par un homme aussi batailleur, il l'expédie outre-Méditerranée,
conquérir la péninsule ibérique, alors entre les mains des Wisigoths. C'est fait en trois ans (711/713).
Vers 740, le Maroc, encore très peu christianisé, est converti à l'islam.
Quelque part près d'Asilah, une route difficile conduit à l'aride décor, où sont plantés plus
de cent cinquante menhirs, autour d'un tumulus. Bien peu de touristes s'y aventurent.
C'est pourtant là que vécurent les premiers habitants connus du Maroc, il y a quelque
cinq mille ans. À cette époque, l'Afrique du Nord est chaude et humide, le Sahara une
savane peuplée de grands animaux, les vertes vallées du Sud (le Drâa, le
Dadès) sont de
grands fleuves. Bien des siècles plus tard (XIIème siècle avant notre ère), les Phéniciens,
grands navigateurs, créent un port à Lixus, près de Larache et un autre sur l'île de Mogador,
face à notre actuel Essaouira. Puis Carthage s'y implante, comme dans pratiquement tout le bassin
méditerranéen. Les ports que sont aujourd'hui Melilla, Tanger, Asilah datent de cette époque
(VIème siècle avant notre ère), et durant près de cinq siècles, Carthage règne sur l'essentiel
du territoire marocain que nous connaissons. Le royaume de Maurétanie (ne pas confondre avec
la Mauritanie. au nord du Sénégal) gardera son nom après la chute de l'Empire carthaginois
(146 avant J.-C.) et pour les premiers Berbères, ces territoires maritimes s'ajouteront à l'ouest
de l'Algérie. Le royaume est riche. Il exporte de l'huile d'olive, des poissons séchés et marinés,
et envoie à Rome, pour le cirque, des animaux sauvages - lions et éléphants - qui pullulent encore
en Maurétanie. C'est une erreur. Tant de richesses attirent Caligula ; il fait assassiner Ptolémée,
le fils du souverain berbère Juba Il et, après quatre ans d'une guerre sans pitié, l'empereur Claude
déclare la Maurétanie, province romaine (en 42), ce qui en fait une suite naturelle des provinces Bétiques
(andalouses),où Claude est déjà implanté... Il s'en tient prudemment aux villes dont
il a besoin : Ceuta, Tingis (Tanger), Sala, Volubilis (la richesse du site montre le profit tiré de
leurs nouveaux territoires par les Romains) et laisse les seigneurs berbères gouverner le reste
du territoire et lui apporter leurs tributs. Cela dure six siècles. Comme toujours dans l'histoire,
c'est la richesse du pays qui attire les ennemis. Les Arabes venus de Tunisie mettront trente ans
à soumettre les Berbères, mais en 710, Ibn Noussair prend le pouvoir ; il nomme Tarik gouverneur
de Tanger et, histoire de ne pas être encombré par un homme aussi batailleur, il l'expédie outre-Méditerranée,
conquérir la péninsule ibérique, alors entre les mains des Wisigoths. C'est fait en trois ans (711/713).
Vers 740, le Maroc, encore très peu christianisé, est converti à l'islam.
 Des Idrissides aux Alaouites
Des Idrissides aux Alaouites
En 788, un chérif arabe s'installe à Volubilis, fait amitié avec les chefs berbères et crée
une ville, Madinat al-Fas (Fès), dont il se couronne roi, sous le nom de Idriss 1er.
Pendant deux cents ans, les assassinats se succèdent ; Omeyyades espagnols et Fatimides tunisiens
s'affrontent. De même que, en Andalousie, la guerre de succession wisigothique avait ouvert la porte
aux Berbères, une grande tribu de nomades sahariens va régler les conflits marocains, en s'emparant
du pouvoir.
En 1073, un chef almoravide, Youssef ben Techfine entame la conquête du nord du Maroc,
de l'Algérie et d'al-Andalus, soit un puissant empire musulman, sur lequel les Almoravides
régneront jusqu'au milieu du XIIème siècle, avant que leur chef ne soit assassiné par
les Almohades. En 1150, le calife almohade Abdel Moumen règne sur un gigantesque empire. l'Espagne,
le Maghreb entier et jusqu'à la Libye. Les Rois catholiques espagnols ne vont pas tarder
à lui en reprendre une partie. La reconquista dure deux cent quatre-vingts ans (1212/1492),
et cette longue période est aussi le commencement de la fin pour les Almohades.
Les Mérinides, une tribu de nomades venue cette fois du Sud algérien (Tlemcen), avancent vers
le nord du territoire, créant au passage des pistes caravanières dont ils ont besoin,
et qui préfigurent une partie des routes actuelles. En 1276, le premier sultan mérinide,
Abou Youssef Yacoub s'installe à Fès et monte jusqu'à Marrakech. Plus cultivés que guerriers,
les trois sultans Mérinides qui se succèdent en quatre-vingt-dix ans, n'agrandiront pas leur
royaume, mais ils donneront au Maroc un élan intellectuel, bâtiront les villes impériales,
avec ce faste dont nous retrouvons la trace (la Koutoubia, la tour Hassan, la Giralda de Séville)
et encourageront lettrés et voyageurs à aller voir le monde, à raconter ce qui se passe dans les
étranges pays qu'ils ignorent. C'est ainsi qu'Ibn Battuta visitera La Mecque, une partie de la
Russie et l'Asie centrale, l'Inde, les Maldives et jusqu'à Pékin et Ceylan, avant l'Espagne et
l'Afrique noire. Et, des décades durant, ses récits feront autorité dans le monde, en matière
de connaissances géographiques. Cette élégante culture ne suffit pas à leur garder le trône.
Le dernier des Mérinides est assassiné par un proche et, après la longue période de gabegie
qui suit, les Portugais mettent la main sur les côtes atlantiques marocaines. C'est à eux
que les ports d'Asilah, de Tanger, Larache, Agadir, Essaouira, Safi... doivent leurs massives
fortifications. Leurs brutalités, les razzias, les assassinats auxquels ils se livrent, finiront
par provoquer une révolte dans la population. Des chorfa (chérif, au pluriel), qui se disent descendants
du Prophète, se répandent dans les campagnes, prônant la djihad, la résistance aux Portugais chrétiens,
donc infidèles. Les Saadiens, soi-disant chorfa, qui prennent la tête du mouvement, n'ont évidemment pas
la seule défense de la religion en tête. Ils agissent en opportunistes, en s'emparant des pistes
caravanières. Leur excès d'ambition ramènera les Portugais et offrira le pouvoir à d'autres
dynasties. Pour faire court, on peut dire que de 1511, arrivée des Saadiens, à 1664, guerres
contre les chrétiens et guerres civiles se succèdent. Jusqu'à l'arrivée de Moulay Ali Chérif,
le premier des Alaouites. Près de huit siècles plus tard, passé des guerres et un protectorat,
la dynastie est toujours au pouvoir...
 Du siècle des lumières à l'indépendance
Du siècle des lumières à l'indépendance
Avec des hauts et des bas, les fils de Moulay Chérif finiront de donner au Maroc
l'essentiel de sa splendeur actuelle. Le plus brillant des souverains alaouites, Moulay Ismaîl,
contemporain de Louis XIV, crée notamment Meknès, mais aussi fait aussi construire Essaouira,
tel que nous le connaissons, et au pied de la colline de Anfa, édifie la ville qui va devenir
le plus important port d'Afrique du Nord, Casablanca. Mais la paix semble un vain mot au Maroc.
Le grand Moulay Ismaîl mort en 1727, les tribus de l'Atlas, n'ayant plus à craindre sa main de fer,
commencent à s'agiter, cherchent à conquérir les côtes ; les factions religieuses sèment le trouble
dans les campagnes fils et frères se disputent le pouvoir. Le Maroc est criblé de dettes, ne possède
pas d'armée. À partir de 1800, Espagnols et Français vont profiter de ces divisions.
Les Européens commencent à créer des « consulats », c'est-à-dire des comptoirs
commerciaux , en 1930, ils sont près de cent mille installés un peu partout au Maroc ;
ils seront un demi-million à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1844, les Marocains perdent
la bataille de l'Isly (Algérie) ; en 1859, les Espagnols se lancent à l'assaut du Sahara ;
comme sous la France féodale, de nombreux caïds (seigneurs) ont plus de pouvoir que le sultan,
tel le Glaoui de Marrakech.
En 1906, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, est à Tanger. L'année suivante,
sous le prétexte de pacifier la région, les Français déjà installés en Algérie,
traversent le Maroc occidental et, après quelques combats contre les Espagnols (au sud)
et les Allemands (Agadir), offrent leur « protectorat » au sultan Moulay Hafid. Celui-ci signera
avec Lyautey, le 30 mars 1912, le traité de Fès, qui lui laisse un pouvoir apparent seulement.
Ce qui n'empêchera pas des milliers de Marocains d'aller se battre sur les fronts sanglants
de Verdun et de la Somme, durant la guerre de 1914/1918. Toutefois, le Maroc profite d'un début
de modernisation, et ses enfants apprennent "nos ancêtres les Gaulois..." De 1939 à 1945, une fois
de plus, les Marocains s'engagent aux côtés des Français, dans la Seconde Guerre mondiale, mais
l'heure des revendications a sonné. Les mouvements indépendantistes s'agitent depuis quinze ans
et le sultan Mohammed ben Youssef réclame l'indépendance.. Pour toute réponse, il est déporté à Madagascar en 1953.
Deux ans plus tard (novembre 1955), la France, incapable de contenir les factions qui se soulèvent de toutes parts,
le rappelle. Accueilli en triomphe par son peuple, Mohammed V exige l'indépendance.
Le traité est signé le 2 mars 1956. En octobre, l'Espagne quitte l'essentiel du nord et Tanger...
 De Mohammed V à Mohammed VI
De Mohammed V à Mohammed VI
 En quelques années de règne, le roi Mohammed V réussit un presque miracle : il est I'homme
qui a libéré le Maroc, il fait l'unanimité autour de son nom, de ses réelles qualités. Il utilise
les progrès que le protectorat a pu apporter au pays et a l'intelligence de permettre aux étrangers
de continuer leurs entreprises, conscient de ce qu'ajoutent ces capitaux à l'économie de Maroc.
En quelques années de règne, le roi Mohammed V réussit un presque miracle : il est I'homme
qui a libéré le Maroc, il fait l'unanimité autour de son nom, de ses réelles qualités. Il utilise
les progrès que le protectorat a pu apporter au pays et a l'intelligence de permettre aux étrangers
de continuer leurs entreprises, conscient de ce qu'ajoutent ces capitaux à l'économie de Maroc.
Il n'aura malheureusement pas le temps de mener à terme son projet de souveraineté démocratique.
Le 26 février 1961, il meurt sur une table d'opération. Bien des Marocains le pleuraient encore
des décades plus tard... Son fils Hassan Il monte sur le trône.. et tout change. Le nouveau roi est
un homme d'une rare culture, arabe comme française. Il a été formé par son père, a une très haute
conscience de son pouvoir et règne avec autorité sur toutes les affaires politiques, religieuses
et militaires. Hassan vit royalement. il ne cache pas ses sympathies francophiles. Pour une jet
set parfois voyante, il organise des fêtes mémorables, de fastueuses diffas. Il voyage. Cela
choque une population, dont une grande partie vit « au-dessous du seuil de pauvreté », comme
on l'écrit aujourd'hui i, et sans la moindre assistance médicale. Les intellectuels commencent
à dire tout haut ce que les pauvres n'osent pas formuler. Et les factions endormies se réveillent.
Hassan Il échappe par miracle à des émeutes qui le visent, à un attentat jusque dans son palais,
à l'attaque de son avion personnel. I'Istiqlal, qui avait milité pour l'indépendance aux côtés
de son père, se rebelle. Comme dans toute révolte, un intellectuel, prend la tête des factions,
Mehdi ben Barka. Plus grave pour la couronne, une partie de l'armée, menée par le général Oufkir,
soutient ben Barka. Jusqu'en 1972, les répressions sont dures. Les deux hommes disparaissent et
leurs familles sont exilées. En 1975, Hassan lance une action géniale. Les Espagnols (le Polisarjo)
lui disputent toujours le Sahara occidental. Alors le roi prend la tête d'une « marche verte » et,
suivi d'une troupe qui grossit à chaque village, marche sur le Sahara. Les gens simples ont besoin
d'images. Comme la « longue marche » de Mao avait rassemblé la Chine derrière lui,
la « marche verte » de Hassan Il enchante le peuple marocain, qui oublie provisoirement ses griefs.
Puis la propagande monte habilement en épingle la chance qu'il a eu d'échapper aux attentats.
Sans nul doute, Allah le protège, Il a la « baraka ». En Europe, il a une cote excellente.
Il ouvre largement le pays aux investisseurs étrangers, qui couvrent la côte Atlantique et
les abords des villes impériales (surtout Marrakech) d'hôtels - clubs, de golfs. Au point d'agacer
souvent l'élite marocaine. C'est un fin politique et il est vrai - entre autres - que le Maroc
affichera toujours un islam très modéré et que le roi se pose quasiment en médiateur entre la Palestine
et Israël. Cependant, malgré la spectaculaire « marche verte », une guérilla larvée continue avec
le Polisario, et l'ONU commence à parler d'intervention... En 1990, le Maroc donne donc des signes
de détente intérieure. Le roi libère quelques prisonniers politiques ; une Chambre basse est élue
au suffrage universel et les premières élections du pays ont lieu en 1997. Pas trop manipulées...
Le 23 juillet 1999, Hassan Il meurt « des suites d'une longue maladie » et son fils aîné, Mohammed VI,
monte sur le trône. Il a trente-cinq ans, et l'habitude de représenter son père depuis l'âge de huit ans.
Il a fait ses études à l'école du palais et, contrairement à la plupart des jeunes Marocains nantis,
à la faculté de droit de Rabat ; il a aussi travaillé avec Jacques Delors à Bruxelles et soutenu sa thèse
de droit à Nice, sur le thème de la coopération de l'Europe et du Maghreb. Il trouve une situation
intérieure désolante. Seulement cinquante pour cent des hommes et trente pour cent des femmes
sont alphabétisés ; un quart de la population urbaine est au chômage ; l'assistance médicale
est toujours inexistante... Le début de son règne est spectaculaire. En quelques semaines,
il se débarrasse de Driss Basri, ministre de l'Intérieur et - on le dit assez haut homme
de main très impopulaire, autorise le retour d'Abraham Sarfaty et semble vouloir enfin
lancer le Maroc vers la modernité, et une politique sociale. Il s'entoure de jeunes cadres,
qu'il connaît depuis ses études. La Bourse de Rabat devient une place monétaire moderne.
En quelques mois, sa popularité grimpe en flèche. Lorsqu'il conduit une cérémonie officielle
en grande tenue traditionnelle blanche, il rassure la vieille garde. Lorsqu'il pilote sa voiture,
se promène dans les rues en chemisette, serre des mains, embrasse les vieilles, il ravit le peuple...
Mais les changements tardent à venir. Le jeune roi n'accorde aucune interview et nul ne sait vraiment
qui est « M.VI » ni comment il vit. L'avenir dira ce qu'il fera de son royaume...
|
|
Acheter des livres chez amazon.fr
|
|
Maroc : tribus, makhzen et colons. Essai d'histoire économique et sociale
|
 Profondément original à plus d'un titre, le Maroc présente des particularités sociales,
politiques et économiques qui ne cessent d'intriguer les observateurs les plus avertis de
la réalité du monde arabe et africain. Ce livre, en étudiant, à partir d'une documentation dense
et plurielle, les mécanismes socio-économiques fondamentaux d'évolution et de fonctionnement
de la société marocaine, contribue certainement à combler une lacune. Mais le travail serait
inachevé et l'entreprise manquerait d'élan si ce destin singulier que connaît le Maroc ne faisait
pas l'objet d'un essai d'interprétation. Ainsi, en se penchant sur une période décisive
de l'histoire du Maroc, l'auteur analyse en détail et s'interroge sur le Processus de transformation
d'une société en mouvement, en mettant en lumière les conséquences contradictoires de l'implantation
capitaliste au Maroc. En raison de l'importance des questions traitées, de la densité et
de la qualité de l'information, cette publication vient à son heure et fait de cet ouvrage
un remarquable instrument de travail qui ne manquera pas d'ébranler bien des certitudes Profondément original à plus d'un titre, le Maroc présente des particularités sociales,
politiques et économiques qui ne cessent d'intriguer les observateurs les plus avertis de
la réalité du monde arabe et africain. Ce livre, en étudiant, à partir d'une documentation dense
et plurielle, les mécanismes socio-économiques fondamentaux d'évolution et de fonctionnement
de la société marocaine, contribue certainement à combler une lacune. Mais le travail serait
inachevé et l'entreprise manquerait d'élan si ce destin singulier que connaît le Maroc ne faisait
pas l'objet d'un essai d'interprétation. Ainsi, en se penchant sur une période décisive
de l'histoire du Maroc, l'auteur analyse en détail et s'interroge sur le Processus de transformation
d'une société en mouvement, en mettant en lumière les conséquences contradictoires de l'implantation
capitaliste au Maroc. En raison de l'importance des questions traitées, de la densité et
de la qualité de l'information, cette publication vient à son heure et fait de cet ouvrage
un remarquable instrument de travail qui ne manquera pas d'ébranler bien des certitudes
 |
|
|
Monarchie et islam politique au Maroc
|
 Ce livre, dont la première édition est parue quelques mois avant la mort du roi
Hassan II, identifie les principaux changements en cours dans le système politique marocain,
en esquisse les limites et en évalue les chances de réussite. La mort d'un roi qui a régné durant
trente©huit ans ouvre une séquence historique durant laquelle les repères peuvent être redéfinis.
Le système marocain est agité par une double tension, qui neutralise toute velléité de transformation
radicale . L'enracinement d'une culture autoritaire, d'abord, qui vaut aussi bien pour la monarchie
que pour la classe politique. La centralité de la religion, ensuite, dans le dispositif de
légitimation du pouvoir en place et dans la construction d'un contre©projet de société.
L'actualité récente conforte l'analyse. Le fonctionnement presque automatique de la succession
à la mort de Hassan II montre bien l'hégémonie d'une culture de cour qui a su gagner en
efficacité en utilisant le potentiel d'un Etat consolidé, sans pour autant perdre du subtil
savoir©faire qui la caractérise et qui donne à la manière dont elle gère les hommes, les situations
et les biens, la qualité d'un travail " cousu main ".Le taouil qui est précisément, en arabe marocain,
le soin, l'art et la manière mis à accomplir un geste, une action, voire à énoncer un propos, a dominé
es quarante jours de deuil observé après la mort de Hassan II. Sous l'harmonie du geste et de la parole,
on retrouve le Makhzen : la culture de cour est réinventée en permanence pour absorber les tensions
et exprimer, sous une patine d'authenticité, les changements de direction, voire les petites révolutions. Ce livre, dont la première édition est parue quelques mois avant la mort du roi
Hassan II, identifie les principaux changements en cours dans le système politique marocain,
en esquisse les limites et en évalue les chances de réussite. La mort d'un roi qui a régné durant
trente©huit ans ouvre une séquence historique durant laquelle les repères peuvent être redéfinis.
Le système marocain est agité par une double tension, qui neutralise toute velléité de transformation
radicale . L'enracinement d'une culture autoritaire, d'abord, qui vaut aussi bien pour la monarchie
que pour la classe politique. La centralité de la religion, ensuite, dans le dispositif de
légitimation du pouvoir en place et dans la construction d'un contre©projet de société.
L'actualité récente conforte l'analyse. Le fonctionnement presque automatique de la succession
à la mort de Hassan II montre bien l'hégémonie d'une culture de cour qui a su gagner en
efficacité en utilisant le potentiel d'un Etat consolidé, sans pour autant perdre du subtil
savoir©faire qui la caractérise et qui donne à la manière dont elle gère les hommes, les situations
et les biens, la qualité d'un travail " cousu main ".Le taouil qui est précisément, en arabe marocain,
le soin, l'art et la manière mis à accomplir un geste, une action, voire à énoncer un propos, a dominé
es quarante jours de deuil observé après la mort de Hassan II. Sous l'harmonie du geste et de la parole,
on retrouve le Makhzen : la culture de cour est réinventée en permanence pour absorber les tensions
et exprimer, sous une patine d'authenticité, les changements de direction, voire les petites révolutions.

|
|
  
| |

