|
L'art de bâtir les villes impériales du Maroc
|
Les rares réalisations idrissides parvenues jusqu'à nous furent influencées par la capitale
arabe Kairouan, en Tunisie, et par la grande métropole d'Orient, Damas. L'édification à Fès
des mosquées al-Qarawiyyîne et des Andalous, au milieu du IXème siècle, annonce les débuts
effectifs de l'art Islamique au Maroc. À partir du milieu du Xème siècle, le pays est à la
croisée des influences de l'Espagne des Omeyyades et de l'Ifriqiya des Fatimides. Progressivement,
sous le règne des Almoravides, l'art du Maroc s'émancipe de l'influence de l'Orient musulman pour
donner naissance au style hispano-mauresque. Damas et Bagdad cessent d'inspirer les créations
artistiques et littéraires marocaines; la recherche philosophique et scientifique, le
savoir-faire architectural et ornemental viennent désormais de Cordoue et de Grenade.
Au contact de la civilisation andalouse, les monarques se font bâtisseurs. Fès et surtout
Marrakech deviennent des foyers permanents de création artistique où les artisans de
l'empire se mettent au service du prince. Dans ses formes mêmes, l'architecture emprunte à
l'Andalousie: l'arc en plein cintre outrepassé, la calligraphie coufique, souvent associée
au décor floral, la stylisation des formes végétales telles que la palme d'acanthe
et l'emploi du stucage font désormais partie du patrimoine ornemental marocain.
Les Almohades vont développer avec profil cet héritage et asseoir les fondements
d'un art que les dynasties postérieures ne feront qu'imiter. La perfection de
la construction de leurs minarets. des portes des enceintes ainsi que l'emploi d'un riche
vocabulaire décoratif consacrent un nouvel essor de l'art hispano-marocain.
Les Mérinides s'efforcent de poursuivre l'œuvre de leurs prédécesseurs. Amoureux des
arts et des lettres, ils accueillent à leur cour poètes, philosophes, juristes, lettrés
et artistes d'Andalousie et du Maghreb. Influencés par le raffinement des cours andalouses,
ils embellissent les villes du royaume d'une multitude de monuments, notamment de
médersas.
dont ils sont les grands bâtisseurs. Si l'art mérinide n'a eu ni la dimension ni la force de
l'art almohade, il rivalise avec lui en harmonie, en élégance et en beauté. Avec les
souverains saadiens, les réalisations artistiques traduisent un attachement à celles
des glorieuses dynasties du passé, signant la continuité d'une tradition solidement
établie au Maroc. Elles s'en distinguent néanmoins par le caractère monumental des édifices,
plus élancés et plus aériens, et par le foisonnement des éléments décoratifs.
Les oeuvres des souverains alaouites, comme les nombreuses mosquées des villes
impériales et la superbe médersa al-Cherrâtine de Fès, se caractérisent par
la perpétuation, dans leurs dimensions formelle et spirituelle, du savoir-faire
et des acquis des siècles précédents, mais expriment aussi la grandeur d'une
culture par son désir de renouvellement. La mise en oeuvre de nouvelles formules
dans la continuité et l'utilisation massive de matériaux comme le zellige ou le
bois peint donnent à l'art alaouite une forme d'exubérance et un langage artistique emphatique.
Comment ont été édifiées les quatre villes impériales? Qui a construit
ces monuments aux décors somptueux qui forcent notre admiration? Dans
l'histoire de l'architecture de l'Islam, on connaît mieux les édifices et les
mécènes qui les ont commandés que les artistes qui les ont créés. On parle de
l'architecture almoravide, almohade, mérinide, et presque jamais de la réalisation
de tel architecte ou de tel maître d'œuvre. En effet, la construction était le
produit du travail d'une multitude de corps de métier spécialisés (maçons,
menuisiers, plâtriers, sculpteurs, charpentiers, peintres ... ), supervisés non
par un architecte tel que nous le concevons aujourd'hui, mais par un maître d'œuvre.
Dans la pratique, la conception du plan des monuments se précisait oralement et
dépendait directement de savoir-faire accumulés pendant des siècles. Parfois,
les édifices complexes se réalisaient sur une longue durée, qui dépassait la vie
d'une génération de bâtisseurs. -Souvent, des mosquées ou des palais voyaient leur
configuration initiale se transformer au cours de la réalisation.
L'évolution des styles architecturaux suivait le goût et les habitudes du
maître du pays et des grands mécènes. Palais, mosquées, médersas et
forteresses étaient le plus souvent le fait du prince, des membres de sa
famille et des riches marchands qui l'entouraient. Pour élever un édifice, il
faisait venir, parfois de très loin, des marbres précieux, du granit, des bois
rares ainsi que divers artisans spécialisés chacun dans un domaine de l'architecture
ou de l'ornementation. Le revêtement des surfaces et des volumes était mieux apprécié
que l'architecture proprement dite. Les citadins avaient peu de considération pour le
rapport des volumes et des plans dans l'espace ; ils admiraient avant tout le décor
abstrait ou épigraphique, la richesse des mosaïques et le travail raffiné du bois.
L'architecture islamique se nourrit ainsi de contrastes surprenants: contraste entre
l'aspect extérieur des murs, dont le parement est monochrome, et la lumineuse splendeur
du revêtement des intérieurs, contraste également entre les espaces arides du dehors et
la splendeur verdoyante du jardin, riyâd, privilège inattendu de l'espace intérieur.
L'ornementation arabo-musulmane répond à la stricte norme religieuse de l'islam;
le Hadith (recueil des faits, dits et gestes du Prophète), reste foncièrement hostile à
la représentation des êtres vivants. Cette interdiction, qui part du principe qu'il est
impossible d'imiter l'acte créateur de Dieu, s'explique aussi par le danger de la
perpétuation de l'idolâtrie déguisée en iconolâtrie. Les ornementalistes rejetaient
l'imitation de la nature pour se consacrer exclusivement à la représentation de motifs
abstraits. La culture technique et scientifique de ces artisans, quasiment assimilés à
des lettrés, leur a permis de développer un univers visuel de plus en plus complexe.
L'esthétique marocaine, en s'enrichissant au fil des siècles de mille apports,
évolue parallèlement au développement de la culture savante. Influencées par
les civilisations grecque, perse et hindoue, la pensée rationnelle et abstraite,
l'astronomie, l'algèbre et la géométrie ont occupé l'esprit des lettrés du monde musulman.
Les traités de Pythagore, notamment sur les tracés isométriques, les carrés magiques et
védiques, clés des schémas directeurs de l'ornementation musulmane, les polygones, les
courbes algébriques du décor végétal comme les spirales et la calligraphie sont autant de
thèmes empruntés à d'autres civilisations et approfondis par les penseurs et les artisans
musulmans. Affiliés à des corporations, ces derniers se rassemblaient en confréries d'initiés
qui enseignaient cette pensée en apprenant aux membres l'interprétation des codes hermétiques
dont ils conservaient les secrets. A partir du XVIème siècle, les artisans décorateurs
marocains se contentent d'imiter leurs prédécesseurs. Les conceptions intellectuelles
qui présidaient à la reproduction des formes ne font plus l'objet d'un débat.
 |
 |
 |
|
Éléments de décor en bois. Peint ou naturel, le bois sculpté est très présent dans l'ornementation marocaine
|
Les compositions géométriques complexes invitent l'œil à suivre la continuité de
leur déploiement en un rythme vigoureux; et si les limites du support n'exigeaient
leur interruption, elles se développeraient en tous sens à l'infini. Dans ce système sans
commencement ni fin, le plein et le vide se valent, l'intérieur et l'extérieur de la forme
se répondent. Ainsi, le spectateur. en perpétuelle méditation, n'est jamais arrêté par
tel ou tel élément central, son regard suit l'enchaînement des lignes qui se nouent et se
dénouent sans cesse, vers un infini devenu tangible. Les motifs et les figures formés par
une combinaison mathématique recouvrent entièrement dans une répétition illimitée l'objet ou le mur.
 |
 |
 |
|
Compositions en Zelliges. Utilisés comme revêtement décoratif sur les murs
des édifices civils ou religieux, les petits carreaux de céramique multicolores
aux formes variées se déclinent en une multitude de combinaisons géométriques dérivées du cercle ou du carré.
|
 |
 |
| Décor en fer forgé. Utilisée pour parer les fenêtres du palais Bennani de Meknès,
l'ornementation en fer forgé se décline en lignes ondulées.
|
Décor sculpté sur pierre. Très délicate, cette composition végétale, réalisée
pour orner le mausolée de Mohammed V à Rabat, est sculptée dans une pierre tendre
|
 Dans le foisonnement des représentations ornementales, on distingue trois grands
répertoires : les motifs géométriques, l'ornementation à base de courbes
(calligraphie, décor floral) et les mouqarnas, alvéoles ou stalactites
sculptées disposées en encorbellement ou en pendentif. Pour habiller les surfaces,
l'artisan dispose de matières fort diverses: la terre cuite émaillée, le plâtre, le marbre,
le bois. La première sert à un revêtement de marqueterie, appelé zellige. Ces faïences
enrichissent les surfaces horizontales et verticales par des compositions savantes, magnifiant
ainsi les formes architecturales par la polychromie et la vibration des couleurs. La technique
consiste à coller sur le mur de petits motifs géométriques de zelliges de différentes couleurs,
taillés à la main selon différentes formes, qui dessinent des figures se répétant sur toute la
surface. C'est l'ornementation géométrique à base de ligne droite qui fournit ses thèmes au
zellige. Les chambres, elles, sont parfois entourées d'une frise épigraphique en faïence émaillée
qui sépare la surface inférieure, revêtue du zellige, et la partie supérieure, recouverte de plâtre
ciselé. Ce type de zellige consiste en carreaux de terre cuite émaillée que les artisans « excisent»
tout autour des formes des lettres et des rinceaux qui les ornent. Enfin, la terre cuite sert à
la fabrication des tuiles vertes vernissées (qarmoua) qui recouvrent la toiture et les auvents
des portes. Apanage des édifices importants, ces tuiles vertes, qui couronnent les mosquées,
les demeures luxueuses, et plus particulièrement les bâtiments du palais, sont un signe de
distinction. De même, on reconnaît dès l'extérieur les maisons des riches citadins aux tuiles
vertes qui recouvrent exceptionnellement l'auvent de leurs portes ou de leurs petites fenêtres.
Dans le foisonnement des représentations ornementales, on distingue trois grands
répertoires : les motifs géométriques, l'ornementation à base de courbes
(calligraphie, décor floral) et les mouqarnas, alvéoles ou stalactites
sculptées disposées en encorbellement ou en pendentif. Pour habiller les surfaces,
l'artisan dispose de matières fort diverses: la terre cuite émaillée, le plâtre, le marbre,
le bois. La première sert à un revêtement de marqueterie, appelé zellige. Ces faïences
enrichissent les surfaces horizontales et verticales par des compositions savantes, magnifiant
ainsi les formes architecturales par la polychromie et la vibration des couleurs. La technique
consiste à coller sur le mur de petits motifs géométriques de zelliges de différentes couleurs,
taillés à la main selon différentes formes, qui dessinent des figures se répétant sur toute la
surface. C'est l'ornementation géométrique à base de ligne droite qui fournit ses thèmes au
zellige. Les chambres, elles, sont parfois entourées d'une frise épigraphique en faïence émaillée
qui sépare la surface inférieure, revêtue du zellige, et la partie supérieure, recouverte de plâtre
ciselé. Ce type de zellige consiste en carreaux de terre cuite émaillée que les artisans « excisent»
tout autour des formes des lettres et des rinceaux qui les ornent. Enfin, la terre cuite sert à
la fabrication des tuiles vertes vernissées (qarmoua) qui recouvrent la toiture et les auvents
des portes. Apanage des édifices importants, ces tuiles vertes, qui couronnent les mosquées,
les demeures luxueuses, et plus particulièrement les bâtiments du palais, sont un signe de
distinction. De même, on reconnaît dès l'extérieur les maisons des riches citadins aux tuiles
vertes qui recouvrent exceptionnellement l'auvent de leurs portes ou de leurs petites fenêtres.
 Les compositions décoratives ne sont pas simplement une combinaison savante de formes;
elles relèvent également d'un art de la couleur. Les ornementalistes produisaient
eux-mêmes des pigments à partir de plantes et de minéraux pour les appliquer à leur
matière de prédilection. Ils créaient une palette de couleurs où dominaient les
tonalités de bleu, de vert et de blanc. Certaines couleurs étaient utilisées plus
spécifiquement sur des supports tels que les coupoles, les minarets, les terrasses
et les murs. Il est vraisemblable que les artisans avaient leurs préférences esthétiques
et accordaient une signification symbolique à leurs choix. Ainsi, l'importante utilisation
du bleu et de ses variations dans le zellige confère à cette couleur une place privilégiée
dans l'histoire de l'architecture islamique : initialement liée au phénomène cosmique, elle
est un moyen d'ouverture à l'Absolu.
Les compositions décoratives ne sont pas simplement une combinaison savante de formes;
elles relèvent également d'un art de la couleur. Les ornementalistes produisaient
eux-mêmes des pigments à partir de plantes et de minéraux pour les appliquer à leur
matière de prédilection. Ils créaient une palette de couleurs où dominaient les
tonalités de bleu, de vert et de blanc. Certaines couleurs étaient utilisées plus
spécifiquement sur des supports tels que les coupoles, les minarets, les terrasses
et les murs. Il est vraisemblable que les artisans avaient leurs préférences esthétiques
et accordaient une signification symbolique à leurs choix. Ainsi, l'importante utilisation
du bleu et de ses variations dans le zellige confère à cette couleur une place privilégiée
dans l'histoire de l'architecture islamique : initialement liée au phénomène cosmique, elle
est un moyen d'ouverture à l'Absolu.
L'autre couleur positive largement utilisée par les artisans est le vert. D'après
le Coran, cette couleur, qui assume une relation primordiale avec la nature et la
fécondité, est synonyme d'abondance, de création et d'opulence. Quant au blanc,
c'est essentiellement la couleur de la sagesse. Chez les soufis, mystiques musulmans,
il est le signe de la lumière intérieure, lumière du secret, du mystère vital de la pensée.
Dans le Coran, le blanc est lié à la morale, l'honneur et la dignité; le linceul blanc des
morts en est le symbole.
|
Liens conseillés
|
|
|
Les Villes
impériales du Maroc
|
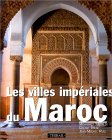  Qui
n'aimerait pas déambuler au coeur de ces villes princières ? Pénétrer
les cours intérieures, visiter les mosquées, s'enfoncer dans le souk, découvrir
la casbah... Bois et stuc sculptés, motifs géométriques, portes ornées,
moucharabieh de bois tournés, ors et mosaïques... Jeu des blancs, des verts et
des ocres... Visiter Fès l'antique, authentique et raffinée, Meknès, le
"Versailles marocain", Marrakech, oasis colorée aux portes des
montagnes de l'Atlas, ou Rabat la blanche, si méditerranéenne ? Fondées
et enrichies par les six grandes dynasties qui ont régné sur le Maroc depuis
le VIIIe siècle, au confluent de l'Espagne mauresque et de l'Orient arabe,
ces villes denses, entourées de remparts, aux formes géométriques, regorgent
de trésors... Pour cette visite, les regards croisés de Mohamed Métalsi,
urbaniste et docteur en esthétique, et de deux photographes, Cécile Tréal et
Jean-Michel Ruiz, permettent de voir et de comprendre la structure, l'art et
l'histoire de ces villes... De superbes photos de portes ouvragées, de palais
(tels le magnifique palais Dâr al-Moqri à Fès, de la fin du XIXe siècle)
de fontaines, de mausolées... qui nous entraînent au coeur de la médina
(ville historique) voisinent avec l'évocation d'Idriss II, fondateur de Fès.
Les villes impériales du Maroc ouvre une fenêtre sur la culture et
l'histoire du Maroc et de l'islam. L'ouvrage propose en annexe des plans, une
chronologie et un glossaire des termes architecturaux employés. Qui
n'aimerait pas déambuler au coeur de ces villes princières ? Pénétrer
les cours intérieures, visiter les mosquées, s'enfoncer dans le souk, découvrir
la casbah... Bois et stuc sculptés, motifs géométriques, portes ornées,
moucharabieh de bois tournés, ors et mosaïques... Jeu des blancs, des verts et
des ocres... Visiter Fès l'antique, authentique et raffinée, Meknès, le
"Versailles marocain", Marrakech, oasis colorée aux portes des
montagnes de l'Atlas, ou Rabat la blanche, si méditerranéenne ? Fondées
et enrichies par les six grandes dynasties qui ont régné sur le Maroc depuis
le VIIIe siècle, au confluent de l'Espagne mauresque et de l'Orient arabe,
ces villes denses, entourées de remparts, aux formes géométriques, regorgent
de trésors... Pour cette visite, les regards croisés de Mohamed Métalsi,
urbaniste et docteur en esthétique, et de deux photographes, Cécile Tréal et
Jean-Michel Ruiz, permettent de voir et de comprendre la structure, l'art et
l'histoire de ces villes... De superbes photos de portes ouvragées, de palais
(tels le magnifique palais Dâr al-Moqri à Fès, de la fin du XIXe siècle)
de fontaines, de mausolées... qui nous entraînent au coeur de la médina
(ville historique) voisinent avec l'évocation d'Idriss II, fondateur de Fès.
Les villes impériales du Maroc ouvre une fenêtre sur la culture et
l'histoire du Maroc et de l'islam. L'ouvrage propose en annexe des plans, une
chronologie et un glossaire des termes architecturaux employés.
Ces extraordinaires photographies nous montrent en détail et en gros plans
l'architecture saharienne du Maroc, depuis les Maures. Ces zelliges (briques émaillées)
aux couleurs du sable rouge marocain et du bleu méditerranéen donnent aux édifices
et aux monuments des reliefs uniques. Les vasques à l'entrée des mosquées
incitent à la purification avant d'y pénétrer. Un livre d'une grande qualité
visuelle que l'on regarde avec émotion et recueillement.
 |
|
 

| |
